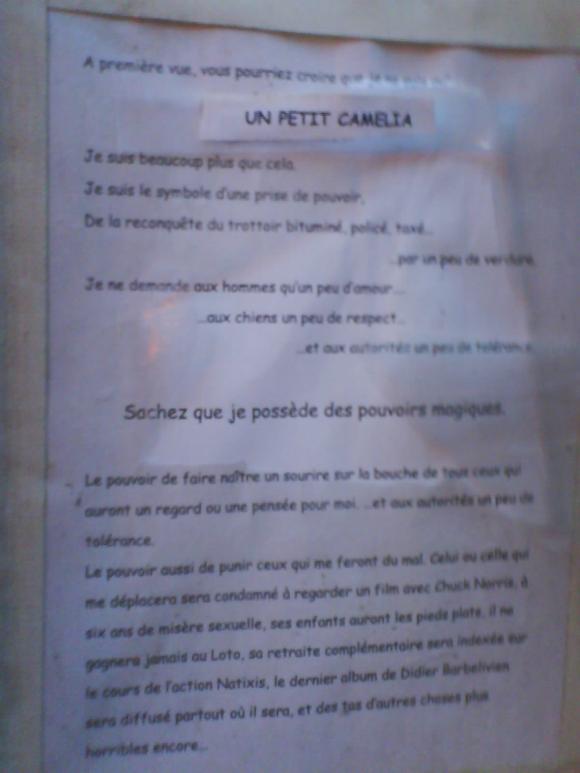Je ne dis plus grand-chose. J'aurais pu parler de la fin laborieuse de mon année de khâgne. D'une longue attente des notes du concours en vue de monter un dossier d'équivalences à la Sorbonne. De ma recherche d'appartements à Paris au mois de juillet : il m'aura fallu un peu plus d'une semaine pour trouver. De ma réception tardive des notes, moins terribles que je ne l'aurais cru. De ma nouvelle activité au sein d'une association qui organise des festivals et concerts de rock. De la mort atroce de Ludmilla, connaissance un peu perdue de vue mais avec qui j'avais passé beaucoup de temps à une époque, percée de huit coups de couteau (la police hésite entre un couteau et un tournevis)... Je fais état de tout cela froidement, car, lorsqu'on n'écrit plus « à chaud », et lorsqu'on a déjà abordé le sujet une centaine de fois avec son entourage, on n'a pas envie de recommencer. La mort seule ne nous a pas rendu visite, cependant : une nouvelle personne a fait son entrée dans la famille, ma nièce Clémence.
J'aurais pu évoquer le temps passé à la plage avec des amis. Le meilleur moment c'est la nuit, lorsque les touristes sont partis ; ce moment où l'on peut plonger ses pieds nus dans le sable frais, y retrouver la tiédeur cachée sous la surface, le faire couler entre ses doigts puis s'asseoir, se laisser bercer par la voix profonde de la mer qui chante à l'unisson de votre cœur dont les coups sont comptés, vous le savez, vous devez absorber cet instant pour ne rien en perdre, ouvrir les yeux sur le reflet de la lune sur l'eau, vous lever, y plonger les chevilles, rester hypnotisé par le va-et-vient des vagues et le jaillissement incessant de l'écume, rester immobile et chantonner jusqu'à ce qu'un ami inquiet vous tire de votre torpeur, parce qu'une personne qui reste à regarder dans le vide comme ça, vous comprenez, ce n'est pas normal...
J'aurais pu faire allusion aux nombreuses sorties entre amis dans un bar dont nous sommes devenus des habitués et dont nous connaissons à présent le serveur.
J'aurais pu ne pas éviter le sujet de l'incendie qui ravagé plus de 2000 hectares tout près de chez mes parents, où j'ai passé l'été. C'était une impression si étrange. Le ciel était rouge, la colline d'en face brûlait, et dans cette atmosphère de fin du monde on vaquait à nos occupations habituelles en attendant de savoir si l'on devrait évacuer, tout en jetant régulièrement un coup d'œil en direction du feu. Dans la soirée, la situation a changé : on ne voyait plus seulement le feu au loin, mais on l'entendait crépiter et on sentait le bois brûler. Les flammes, poussées par le vent, se propageaient à une vitesse folle et léchaient toutes les crêtes des collines d'en face, puis descendaient leurs flancs en notre direction. L'horizon entier se consumait. Les flammes devenaient si grandes qu'elles semblaient n'être qu'à une centaine de mètres. Il a fallu se poser sérieusement la question : que doit-on sauver si l'on doit partir ? Étrangement, je n'ai pas eu peur. Je me suis aperçue que parmi les objets de la maison, peu de choses étaient vraiment importantes. Nous nous sommes demandé si l'on viendrait nous avertir quand le feu menacerait le village, auquel cas nous pouvions nous permettre de dormir un peu, ou si l'on devait garder les yeux rivés sur le feu. Mes parents ont choisi la seconde option (mon père ayant abondamment filmé et photographié, je suppose qu'il aurait emporté son appareil en cas d'évacuation) et moi la première. Quand, pour une raison inconnue, je me suis réveillée vers six heures, ma première pensée a été pour le feu. Je me suis levée pour le voir : il faisait encore nuit et le feu était toujours là, mais ne semblait pas avoir progressé vers nous. Je n'ai pas réussi à me rendormir, car, à chaque fois que je glissais dans un demi-sommeil, des flammes dansaient devant mes yeux. Quelques heures plus tard, le feu était sous contrôle. Au cours de la journée, les canadairs se sont succédé au-dessus de nos têtes, évoquant un peu la bande-son d'un film de guerre. En Occident, on a parfois le sentiment de vivre dans un monde où tout est encadré par des normes, sécurisé, aseptisé. Il serait pourtant faux de croire que notre vie est prévisible et sans danger : du jour au lendemain on peut se faire renverser par une voiture, se faire poignarder, mourir dans un incendie. Parfois un événement comme celui-ci nous réveille, on sent qu'on ne domine pas tout, que notre vie ou notre situation ne tient qu'à un fil... C'est cette fragilité qui rend l'existence si belle.
Me voici à Paris, à présent. Je ne suis toujours pas inscrite dans mes facs, car la Sorbonne n'a pas donné de réponse à mon dossier de validation. Je vais les voir presque tous les jours, sans résultat. Pour recevoir ma bourse du CROUS, je dois m'inscrire d'abord en 3ème année d'Anglais : si je valide en premier mon inscription en Turc débutant à l'INALCO, le CROUS considèrera que j'ai « régressé » et ne me donnera rien. Dans un premier temps, j'ai fait une « inscription provisoire » à l'INALCO, qui me permet de suivre les cours mais sans avoir de carte étudiante ni de couverture santé. Je me suis aussi renseignée à la Sorbonne : je peux aller en cours sans être inscrite, si les professeurs m'acceptent, car je ne suis apparemment pas la seule dans mon cas. J'ai donc un petit délai pour régler ma situation, mais ce n'est pas pratique du tout, je n'ai même pas le droit à la carte de transport étudiante de Paris... Je fais donc ma « rentrée » en auditrice libre lundi. En attendant, je fais le ménage (chose que le locataire précédent n'a pas faite), je me promène, et j'ai reçu pendant quelques jours O** qui s'ennuyait en Belgique. Je n'ai que quelques marches à monter pour aller à Montmartre et j'y vais de temps en temps, car j'aime beaucoup ces rues (et en plus ça me muscle les jambes), même si je me fais aborder par les gens qui vendent des trucs et des machins pour touristes. En général, quand ils se rendent comptent que je suis Française, ils me proposent une réduction. O** et moi avons même eu des « guru-guru » gratuits (c'est comme des bracelets brésiliens, mais c'est Africain) après avoir longtemps protesté contre plusieurs Guinéens qui voulaient nous les vendre et qui nous les ont finalement offerts parce que « on était mignonnes ». Une autre fois, je me suis faite intercepter par un dessinateur qui voulait faire mon portrait : « Non merci », ai-je dit. « Ah ! Tu es Française ? C'est gratuit pour les Français ! ». Mais deux minutes après, il voulait me le faire à dix euros (« ben oui, c'est presque gratuit ») et comme je n'avais franchement pas besoin d'un portrait de moi-même, je ne l'ai pas fait. Au passage, il m'a demandé mon âge, a tenté de me faire croire qu'il avait vingt-et-un ans (il en paraissait entre vingt-cinq et trente) et de savoir si j'avais un copain (« Tu pourras offrir ce portrait à ton copain... Quoi, tu n'as pas de copain peut-être ? »).
À Montmartre, on croise aussi beaucoup de musiciens. C'est ainsi qu'avec O**, nous avons fait la rencontre de Storia, qui joue du hang (instrument de percussion qui ressemble à une soucoupe volante en métal et ne peut s'obtenir qu'en se rendant directement auprès des gens qui l'ont créé) et s'accompagne de sa voix magnifique. Sa musique évoque un peu celle de Loreena McKennit, et vous pouvez faire un tour sur son myspace. J'ai aussi vu hier un homme qui jouait « Hey Jude » à la contrebasse, c'était original. J'aime Montmartre...